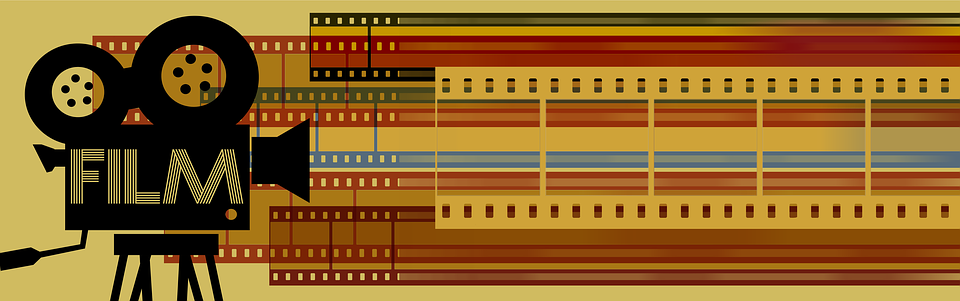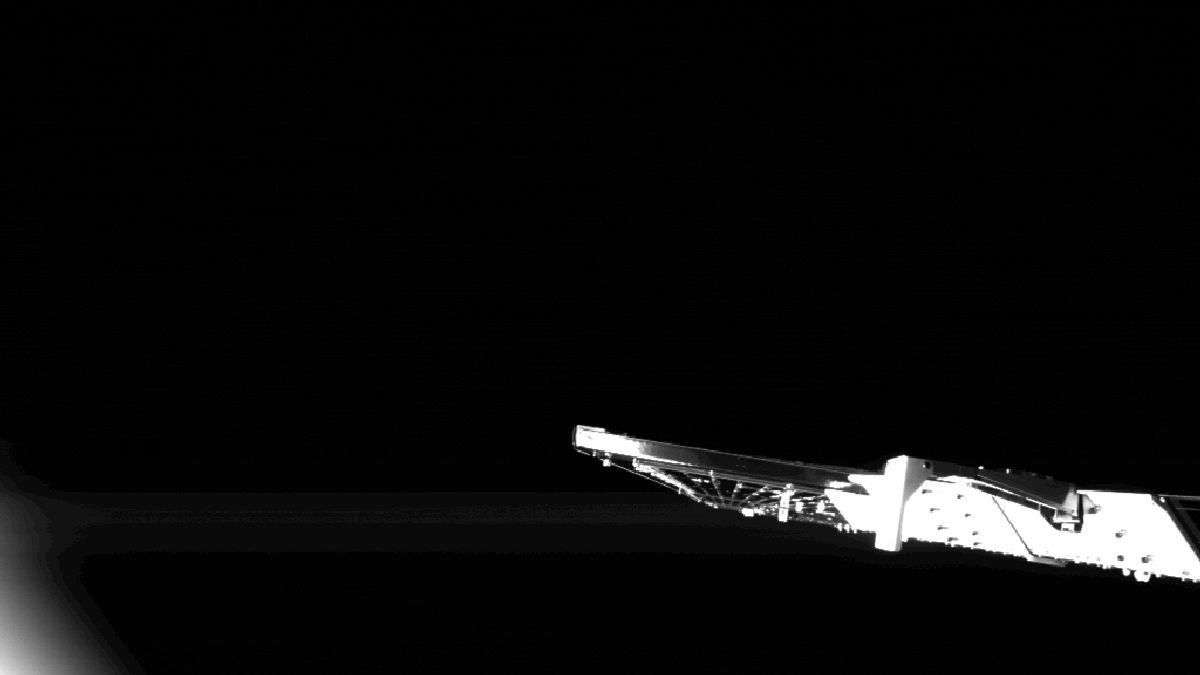Top News
Le cinéaste de la Nouvelle Vague Godard a vécu le respect de la France pour les États-Unis avec amour et haine

Jean-Luc Godard, cinéaste français radical, a toujours été un farouche opposant à l’iconographie. Il a dit un jour : « Une histoire doit avoir un début, un milieu et une fin, mais pas nécessairement dans cet ordre. »
Mais M. Godard, décédé cette semaine, était aussi un symbole de l’ambiguïté de la France sur les Etats-Unis, à la fois fascinée et méprisée par la culture américaine. Il a passé des décennies à imiter, citer et honorer le cinéma américain, avant de refuser « l’américanisation » du monde et de rompre avec la machine hollywoodienne.
Pourquoi avons-nous écrit cela ?
La réputation révolutionnaire du réalisateur français Jean-Luc Godard ne le rend toujours pas plus populaire auprès des cinéphiles que les réalisateurs américains qui dominent les écrans français.
Cela fait un siècle que les États-Unis ont remplacé la France comme le plus gros chien du monde du cinéma, et plus de 50 ans que les autorités françaises ont commencé à protéger les produits culturels français – comme les films – de la concurrence étrangère.
Pourtant, les films américains réalisent plus de 60 % des recettes du box-office français, et en 2019 un seul film français figurait parmi les 10 premiers en France ; Les autres étaient américains.
Dans une salle de cinéma parisienne mercredi soir, la foule réunie pour regarder le film américain « Thief » avec James Caan était bien plus nombreuse que celle de « My Life to Live » de M. Godard.
Mais un fan du film, le photographe Christoph Kabrilian, s’est senti obligé. « J’adore les classiques américains », a-t-il déclaré. « Mais aujourd’hui, il fallait que je vienne voir Godard. »
Une ligne rampe dans la rue devant La Filmothèque, l’un des cinémas parisiens du célèbre Quartier Latin. Peu de gens sont ici pour regarder « Vivre sa vie », le film de 1962 du réalisateur franco-suisse radical Jean-Luc Godard, décédé mardi à l’âge de 91 ans.
Mais la plupart d’entre eux sont ici pour le film américain classique « Thief » de Michael Mann.
« Je ne regarde généralement que des films anciens, ceux qui représentent l’âge d’or du cinéma », confie Bernard Thorall, grand cinéphile. « J’adore le film noir américain. Godard ? Ce n’est pas grand-chose. Je n’ai jamais vu un de ses films. »
Pourquoi avons-nous écrit cela ?
La réputation révolutionnaire du réalisateur français Jean-Luc Godard ne le rend toujours pas plus populaire auprès des cinéphiles que les réalisateurs américains qui dominent les écrans français.
Cela pourrait surprendre si un visiteur de cinéma français s’acclimatait à un film américain le lendemain de la mort d’une légende du cinéma comme M. Godard, qui a façonné le nouveau style cinématographique improvisé, informel et concis des années 1960, créant une véritable expérience. . Une révolution dans le cinéma français.
Mais le cinéma américain est depuis longtemps un produit culturel en vogue en France, donnant lieu à une relation amour-haine profonde et de longue date qui s’est développée à l’amiable – et avec défi – au cours du siècle dernier. La fascination de la France pour la culture américaine et son mépris en même temps ont conduit à des vagues d’adoration et de mépris, et finalement, disent certains critiques, ont fait de la France une victime de l’impérialisme culturel américain.
L’emblématique M. Godard a illustré cette ambiguïté, passant des décennies à imiter, citer et honorer le cinéma américain, avant de rejeter « l’américanisation » du monde et de rompre avec la machine hollywoodienne.
« Les Français ont une image très contradictoire des États-Unis », constate Bruno Becnot, professeur émérite d’arts et de culture à la Nouvelle Université de la Sorbonne à Paris. Ils estiment que « d’une part, les écrivains et les cinéastes peuvent être très spirituels, intelligents et capables de saisir les nuances, et d’autre part, ils peuvent être sauvages, comme s’ils venaient de sortir d’une grotte ».
« Exception culturelle »
Le cinéma français est vénéré chez lui et à l’étranger ; Aller au cinéma ici est sophistiqué – aucun craquement bruyant de pop-corn n’est autorisé. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, le cinéma français dominait les marchés du monde entier, fournissant 60 à 70 % des films diffusés dans le monde. Après cela, son influence a commencé à décliner et l’industrie cinématographique américaine est devenue la plus importante au monde.
Le cinéma français n’a refait surface qu’à la fin des années 1950, lorsque M. Godard est entré en scène aux côtés de ses collègues cinéastes de la Nouvelle Vague François Truffaut, Jacques Rivette et Claude Chabrol.
C’est à cette époque que le gouvernement français a décidé que la culture française avait besoin d’être protégée. Le ministre français de la Culture, André Malraux, a promu l’idée d’une « exception culturelle française » qui accorde aux produits culturels une place particulière dans les négociations commerciales internationales.
« Malraux était considéré comme un héros du cinéma français, le défendant contre le ‘grand et le mauvais cinéma américain' », déclare Jonathan Broda, historien du cinéma à l’Ecole internationale du cinéma et de la télévision de Paris. « Je dis cela ironiquement, mais le cinéma américain reste domine les écrans français. . »
Depuis l’ère Malraux, les pouvoirs publics se battent pour laisser s’épanouir la culture française. Jack Lang, ministre de la Culture au milieu des années 1980 puis au début des années 1990, s’est notamment montré critique à l’égard de l’hégémonie américaine, appelant à une « croisade » contre cet « impérialisme financier et intellectuel qui… s’empare des consciences, des modes de pensée, des façons de penser. Vivre. » . »
Au début des années 1990, les films américains représentaient plus de 60 % des recettes du box-office français, selon le ministère de la Culture. En 2013, la ministre française de la culture de l’époque, Aurélie Filipetti, a demandé avec succès que le secteur audiovisuel soit exclu des négociations de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne, afin de bénéficier du soutien du gouvernement.
Mais malgré les efforts du gouvernement et la revitalisation du cinéma français, le cinéma américain prévaut toujours. En 2019, un seul film français figurait parmi les 10 meilleurs films du box-office français – les autres étaient américains, dont la majorité était distribuée par les studios Walt Disney.
« Plus que tout autre média, le cinéma représente l’impérialisme culturel », déclare M. Broda. « Si James Dean porte un jean bleu, tout le monde veut porter un jean bleu. Si Marilyn Monroe a bu du Coca-Cola, tout le monde en a bu. Le cinéma est devenu le meilleur ambassadeur de l’économie américaine. »
Controversé pour toujours
M. Godard avait une passion similaire pour le cinéma américain, et son long métrage « A Bout de Souffle » (« A bout de souffle ») s’inspire de la version originale américaine de « Scarface », sortie en 1932. En 1968, il accompagne son film » La Chinoise » en tournée dans les universités américaines et a rencontré l’activiste des Black Panthers Kathleen Cleaver à Auckland.
Mais il avait déjà commencé à se moquer de certains aspects de la vie américaine dans son film de 1963 Le Mépris (« Mépris »), et lorsque la guerre du Vietnam éclata, M. Godard n’hésita pas à exprimer son point de vue sur l’engagement militaire américain. En 2000, la relation s’est détériorée et en 2010, lorsque M. Godard a reçu un Oscar honorifique pour les réalisations de sa vie, il a dit que cela ne signifiait « rien » pour lui et qu’il n’allait pas le chercher.
Bien qu’il soit toujours une icône vénérée du cinéma français, M. Godard a toujours été controversé, tant politiquement que cinématographiquement. (Il a dit un jour qu' »une histoire devrait avoir un début, un milieu et une fin – mais pas nécessairement dans cet ordre ».) Bien que deux de ses films aient remporté des prix au Festival de Cannes, ils n’ont jamais remporté le premier prix, et il n’a pas non plus reçu de prix. un César, qui équivaut aux Oscars en France.
À La Filmothèque, le propriétaire Jean-Max Causse est heureux de voir les gens se tourner vers M. Godard, même s’il sait que ses films ne sont pas du goût de tout le monde. M. Godard a été l’un des premiers clients de M. Cuse lorsqu’il a ouvert son premier cinéma dans le centre de Paris en 1967. M. Truffaut se souvient être venu avec Catherine Deneuve, M. Godard se plaignant bruyamment du volume de la musique.
« Il n’était pas aussi aimé que Truffaut, mais comme ces autres jeunes réalisateurs qui n’avaient jamais fait d’école de cinéma auparavant, il a bousculé la tradition », explique M. Cuz. Le cinéma français est un peu en crise en ce moment. Aux États-Unis, le cinéma commence à sortir des décombres, mais c’est la fin d’une certaine époque. »
Christophe Kabrilian, photographe local, est venu voir « Vivre Sa Vie » pour rendre hommage à cette époque, et son respect à une légende.
« J’adore les classiques américains d’Hitchcock ou de Stanley Kubrick. Ils m’inspirent, confie M. Capelian, qui va au cinéma au moins 10 fois par mois. Mais aujourd’hui, il fallait que je vienne voir Godard sur grand écran. »

« Analyste. Passionné du Web. Pionnier de la bière en devenir. Expert en musique certifié. Amoureux des zombies. Explorateur. Fanatique de la culture pop. »
Top News
La France a aidé plus de 260 personnes à quitter Gaza

Les 17 derniers d'entre eux ont été libérés le 6 avril, selon le ministère français des Affaires étrangères. Ils étaient les ancêtres de citoyens français. Le ministère français des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que « plus de 260 personnes ont pu quitter la bande de Gaza depuis le 1er novembre 2023 ». un permis.
Pour figurer sur la liste qui permet aux personnes de passer par le poste frontière de Rafah, au sud de l'enclave, et d'entrer sur le territoire égyptien, le ministère n'a pas seulement aidé le consulat de France à Jérusalem et l'ambassade de France au Caire à déterminer la nationalité des candidats. Le consul général de France à Jérusalem, Nicolas Cassianides, a déclaré : « Compte tenu de la gravité de la crise, les critères ont été élargis par rapport à d'autres conflits. Les efforts français à cet égard sont sans précédent. »
Les citoyens français étaient d'abord inscrits avec leur conjoint et leurs enfants ; Puis les fonctionnaires français, leurs conjoints, leurs enfants mineurs et ceux qui disposent d'un titre de séjour valide en France. Par la suite, le feu vert a été donné aux enfants majeurs de citoyens français et d’employés de l’État, ainsi qu’aux ancêtres de citoyens français.
Les Palestiniens bénéficiant du statut de réfugié en France peuvent faire venir leur famille s'ils disposent d'un accord de regroupement familial du ministère de l'Intérieur. Les familles des titulaires d'un titre de séjour valide en France pourront être évacuées si la Place Beauvau l'accepte. Tous les Français qui ont demandé à être évacués ont quitté Gaza.
Conflit avec les autorités israéliennes
Avant le départ des 17 dernières personnes, le 6 avril, 242 personnes avaient été évacuées de Gaza vers l'Egypte grâce aux autorités françaises, et 193 d'entre elles étaient parties vers la France. Il s'agissait notamment de 54 citoyens français et 38 des personnes à leur charge, de 11 employés palestiniens de l'Institut français, d'un employé local de l'Agence française de développement et de 78 personnes à leur charge palestiniennes. Les quelques citoyens français restant à Gaza – pas plus de cinq, selon le consulat de Jérusalem – ne sont pas prêts à évacuer dans les circonstances actuelles.
Les autorités égyptiennes ciblent les sorties, exigeant que les Palestiniens restent sur leurs terres moins de 72 heures. Israël a peut-être également ralenti ces mesures. Les responsables du ministère des Affaires étrangères soulignent en privé le conflit avec les autorités israéliennes. « Nous poursuivrons nos efforts sans relâche malgré la difficulté des opérations, notamment le blocus extérieur qui pourrait empêcher ou retarder la sortie », a déclaré Kassianides. Les Israéliens auraient bloqué au moins quatre agents palestiniens affiliés à l'Institut français.
Il vous reste 12,58% de cet article à lire. Le reste est réservé aux abonnés.

« Analyste. Passionné du Web. Pionnier de la bière en devenir. Expert en musique certifié. Amoureux des zombies. Explorateur. Fanatique de la culture pop. »
Top News
Un chiot bouledogue français a été volé lors d'un cambriolage au domicile de Batshuayi

Un chiot a été volé chez lui lors d'un cambriolage à Patchway aux petites heures de ce matin, vendredi 19 avril. Un bouledogue français de 18 mois nommé Frankie a été enlevé dans une propriété du quartier de Wood Street entre 1 heure du matin et 1 heure du matin. 2h du matin ce matin.
On pense que deux criminels ont utilisé une motocyclette pour se rendre à la propriété et en revenir. Avon et la police du Somerset ont lancé un appel pour obtenir des informations sur l'endroit où se trouve Frankie.
Des policiers se sont rendus dans des maisons voisines pour visionner des images de sonnette et de vidéosurveillance de la zone au moment où le cambriolage aurait eu lieu. La police d'Avon et du Somerset a également confirmé que des agents criminels étaient présents aujourd'hui pour mener des enquêtes médico-légales.
En savoir plus:
Les agents aimeraient parler à toute personne susceptible d'avoir des informations sur ce cambriolage. Si quelqu'un a vu une moto à Batshuayi ou a des informations sur l'endroit où se trouve Frankie, veuillez appeler le 101 en indiquant le numéro de référence. 5224099812 .
Vous voulez d’abord être informé des dernières nouvelles et des actualités les plus marquantes de Bristol ? Cliquez ici pour rejoindre notre groupe WhatsApp . Nous proposons également aux membres de notre communauté des offres spéciales, des promotions et des publicités de notre part et de celles de nos partenaires. Si vous n'aimez pas notre communauté, vous pouvez la consulter à tout moment. Si vous êtes curieux, vous pouvez lire notre site internet Avis de confidentialité .

« Analyste. Passionné du Web. Pionnier de la bière en devenir. Expert en musique certifié. Amoureux des zombies. Explorateur. Fanatique de la culture pop. »
Top News
Je ne veux jouer pour aucune autre équipe nationale

Joël Embiid Il sera l'une des grandes stars du tournoi de basket aux Jeux de Paris. Rares sont ceux qui pourront le surpasser. Le centre, sélectionné parmi les 12 membres de la Dream Team, fera ses débuts avec L'équipe américaineMais il y a quelque temps, il avait décidé de jouer pour l'équipe locale.
Le centre des Sixers avait le potentiel pour jouer pour trois équipes nationales : le Cameroun, son pays natal, la France et les Etats-Unis, ses deux autres nationalités. Finalement, il a choisi l’équipe américaine, ce qui a doublé ses chances de remporter l’or. Les fans locaux ne lui pardonneront probablement pas cette décision.
Le joueur a obtenu la nationalité française en 2022, mais des mois auparavant, il avait écrit une lettre à… Le président Emmanuel Macron Il s'est mis au service du basket français.
«Je connais votre intérêt sincère pour Basket-ball « Et son développement et, de manière générale, dans le sport qui honore la France », commence le document publié par « RMC Sport ». « Après discussions avec la Fédération Française de Basket, j'ai déjà pris ma décision. Je souhaite entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir la nationalité française et ainsi être sélectionné par les Bleus. Je ne souhaite jouer pour aucune autre équipe nationale. J'ai a adressé un dossier au ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères », a-t-il reconnu. Le centre dans sa mission.
Embiide Il a déclaré : « Ce sera un grand honneur de rejoindre l’équipe de France pour participer aux prochaines grandes compétitions internationales, notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je mesure le sérieux de ma candidature, ce qu’elle représente, ce qu’elle signifie, mais aussi. , sous certains aspects, sa durée et sa complexité par rapport aux critères habituels d’octroi de la citoyenneté. directement, Sixers – a demandé au joueur Macron « Pour son soutien à ces initiatives, soutien sans lequel elles ne réussiront pas. Veuillez accepter, Monsieur le Président, mon plus grand respect. »
Contexte, famille et voyages en France
Le joueur lui a fait part, pour l'information du Président français, de ses origines, de ses souvenirs au pays, de ses vacances, des proches qu'il y a encore… Son message a été couronné de succès et il a obtenu la nationalité française. Le syndicat se frottait déjà les mains à la possibilité de rejoindre la même équipe Embiid, Victor Wimpanyama et Rudy Gobert, avec qui il a eu de nombreux affrontements lors de leurs duels en NBA. Mais désormais, il sera l’une des stars de l’American Dream Team. trahison.
«Je continue à me déplacer régulièrement à Paris où j'aimerais obtenir une deuxième résidence permanente» Embiide » dit-il dans sa lettre. Il devra peut-être reconsidérer l'achat d'une maison dans la capitale française, car elle risque de ne pas être bien accueillie.

« Analyste. Passionné du Web. Pionnier de la bière en devenir. Expert en musique certifié. Amoureux des zombies. Explorateur. Fanatique de la culture pop. »
-
entertainment2 ans ago
Découvrez les tendances homme de l’été 2022
-
Top News2 ans ago
Festival international du film de Melbourne 2022
-
Tech1 an ago
Voici comment Microsoft espère injecter ChatGPT dans toutes vos applications et bots via Azure • The Register
-
science2 ans ago
Les météorites qui composent la Terre se sont peut-être formées dans le système solaire externe
-
science3 ans ago
Écoutez le « son » d’un vaisseau spatial survolant Vénus
-
Tech2 ans ago
F-Zero X arrive sur Nintendo Switch Online avec le multijoueur en ligne • Eurogamer.net
-
entertainment1 an ago
Seven révèle son premier aperçu du 1% Club
-
entertainment1 an ago
Centenaire des 24 Heures – La musique live fournit une bande-son pour la course